
Présentation des séances de psychopédagogie positive : Comment mémoriser pour m’en souvenir toujours ?
1. Objectif global de la séance
Cette séance vise à dédramatiser la mémoire et à montrer à l’enfant qu’il peut s’y fier.
L’objectif est de comprendre comment fonctionne sa mémoire, comment l’entraîner et comment l’utiliser efficacement dans ses apprentissages.
2. Contenus et démarches de la séance
Comprendre ce qu’est la mémoire
Expliquer que la mémoire est comme une bibliothèque personnelle où l’on range, organise et retrouve des informations.
Montrer qu’il existe plusieurs types de mémoire (visuelle, auditive, kinesthésique, émotionnelle…).
Aider l’enfant à identifier celles qu’il mobilise naturellement.
Apprendre à faire confiance à sa mémoire
Beaucoup d’enfants doutent d’eux et pensent qu’ils « n’ont pas de mémoire ».
Par des petits exercices ludiques, l’enfant expérimente que sa mémoire fonctionne bel et bien.
Renforcer la confiance en ses capacités, indispensable pour apprendre sereinement.
Différencier attention et concentration
Clarifier que :
l’attention = être réceptif à ce qui se passe, capter l’information,
la concentration = rester focalisé, maintenir son effort pour traiter l’information.
L’enfant découvre que ces deux gestes mentaux se musclent et s’entraînent, au même titre que les muscles du corps.
Découvrir et expérimenter des outils de mémorisation
Proposer des méthodes variées :
cartes mentales,
associations d’images,
rituels de révision,
jeux de mémoire,
ancrage corporel ou gestuel.
L’enfant teste ces outils pour trouver ceux qui lui conviennent le mieux.
3. Pourquoi cette séance est-elle essentielle ?
Rassurer l’enfant : il comprend qu’il n’est pas « sans mémoire », mais qu’il peut apprendre à l’utiliser.
Renforcer son efficacité scolaire : mieux mémoriser = gagner du temps et de l’énergie.
Apaiser la relation aux devoirs : l’enfant et ses parents disposent d’outils concrets pour rendre la mémorisation plus ludique et moins stressante.
Développer des habitudes durables : l’enfant apprend à s’organiser et à adopter des stratégies transférables à toutes les matières.
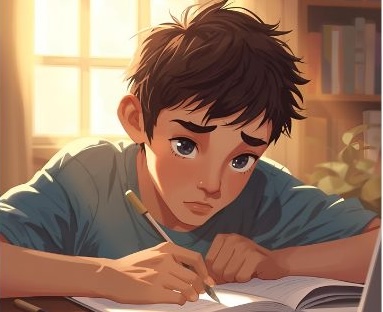
En résumé, cette séance aide l’enfant à réconcilier confiance, attention et outils de mémorisation.
Il repart avec :
une meilleure connaissance de sa mémoire,
la certitude qu’il peut lui faire confiance,
des exercices et stratégies concrètes pour apprendre plus efficacement.




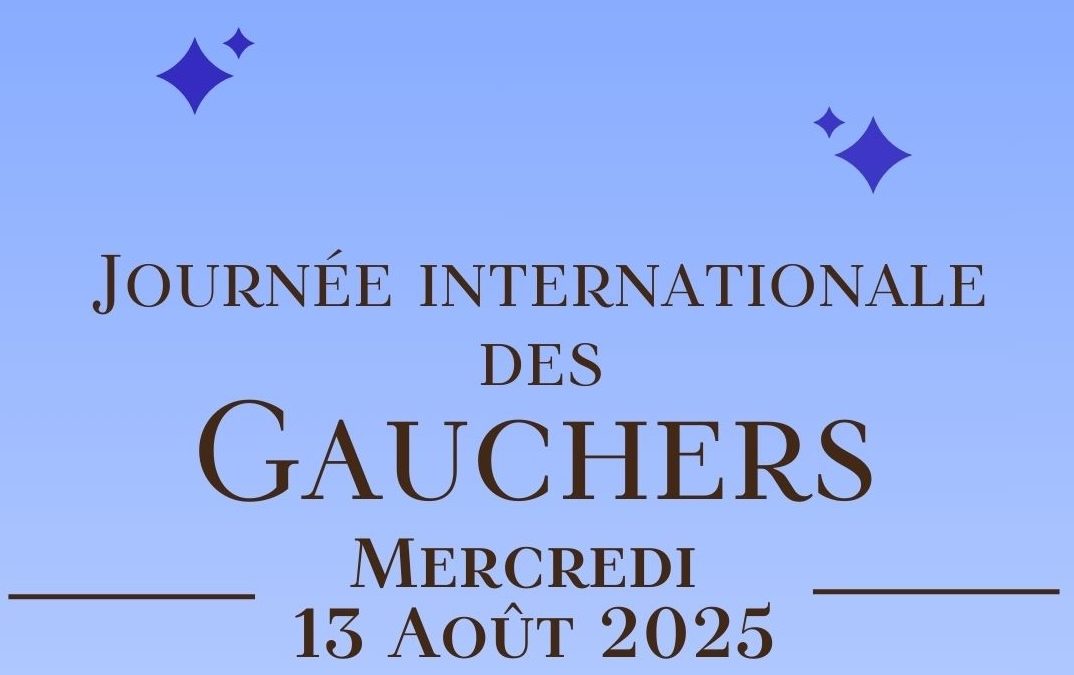
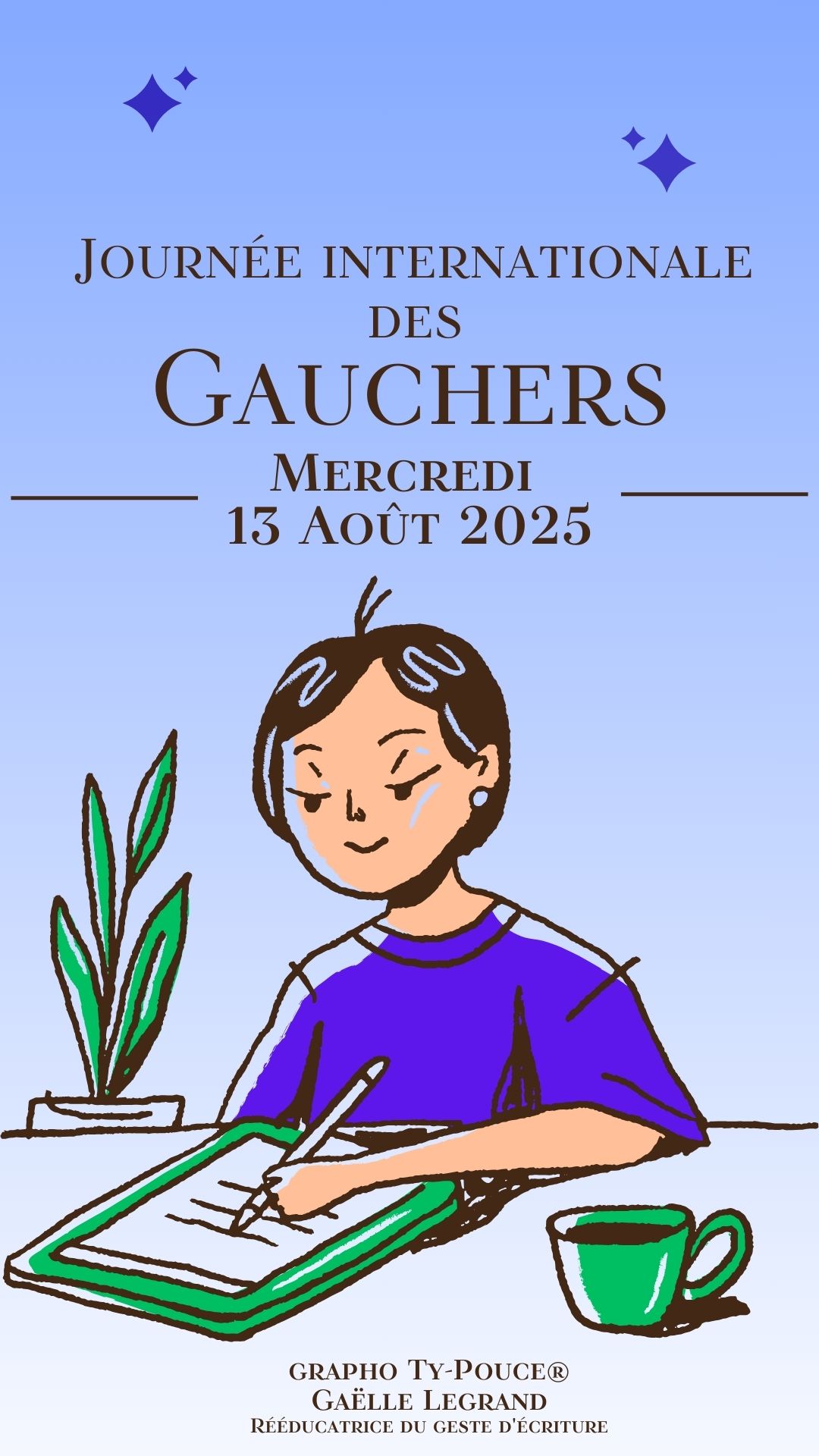











Commentaires récents