
Présentation des séances de la Psychopédagogie Positive : Comment j’apprends quand j’apprends ?
1. Objectif global de la séance
Cette deuxième étape a pour but d’aider l’enfant à mieux se connaître dans ses apprentissages.
Car pour progresser efficacement, il est essentiel que l’enfant sache comment il fonctionne : comment il mémorise, comprend, réfléchit et mobilise ses ressources.
2. Contenus et démarches de la séance
Comprendre ce que signifie « apprendre »
Définir avec l’enfant ce qu’apprendre veut dire pour lui : retenir, comprendre, utiliser, réussir.
Déconstruire certaines idées reçues (« apprendre = réciter par cœur »).
Mettre en avant que l’apprentissage est un processus vivant, fait d’essais, d’erreurs et de réussites.
Identifier sa manière propre d’apprendre
Chaque enfant a une façon personnelle d’aborder les apprentissages.
Observation et échanges permettent de découvrir :
s’il préfère voir (mémoire visuelle),
entendre (mémoire auditive),
ou manipuler/marcher/bouger (mémoire kinesthésique).
Cette étape est fondamentale pour qu’il gagne en efficacité et en autonomie.
Découvrir ses évocations mentales
Apprendre à « se voir/sentir/entendre penser » :
voir des images,
entendre une petite voix intérieure,
ressentir des impressions ou émotions.
L’enfant comprend que ces évocations sont des outils puissants qui l’aident à retenir, comprendre et restituer.
Explorer de nouvelles pistes d’apprentissage
Proposer à l’enfant des stratégies variées pour enrichir sa boîte à outils : schémas, couleurs, cartes mentales, verbalisation, jeux de rôle…
L’aider à tester et expérimenter pour découvrir ce qui lui correspond le mieux.

3. Pourquoi cette séance est-elle importante ?
Développer la métacognition : l’enfant prend conscience de son propre fonctionnement mental.
Renforcer la confiance : il comprend qu’il n’y a pas une seule bonne manière d’apprendre, mais que la sienne est valable et peut s’enrichir.
Donner de l’autonomie : en connaissant ses forces, l’enfant devient plus acteur de ses apprentissages.
Apaiser la relation aux devoirs : les parents comprennent mieux le fonctionnement de leur enfant et peuvent l’accompagner avec des méthodes adaptées.
En résumé, la séance 2 aide l’enfant à se découvrir en tant qu’apprenant.
Il repart avec :
une meilleure compréhension de ce qu’apprendre signifie pour lui,
la découverte de ses propres stratégies naturelles,
et des premières pistes concrètes pour apprendre autrement et plus sereinement.



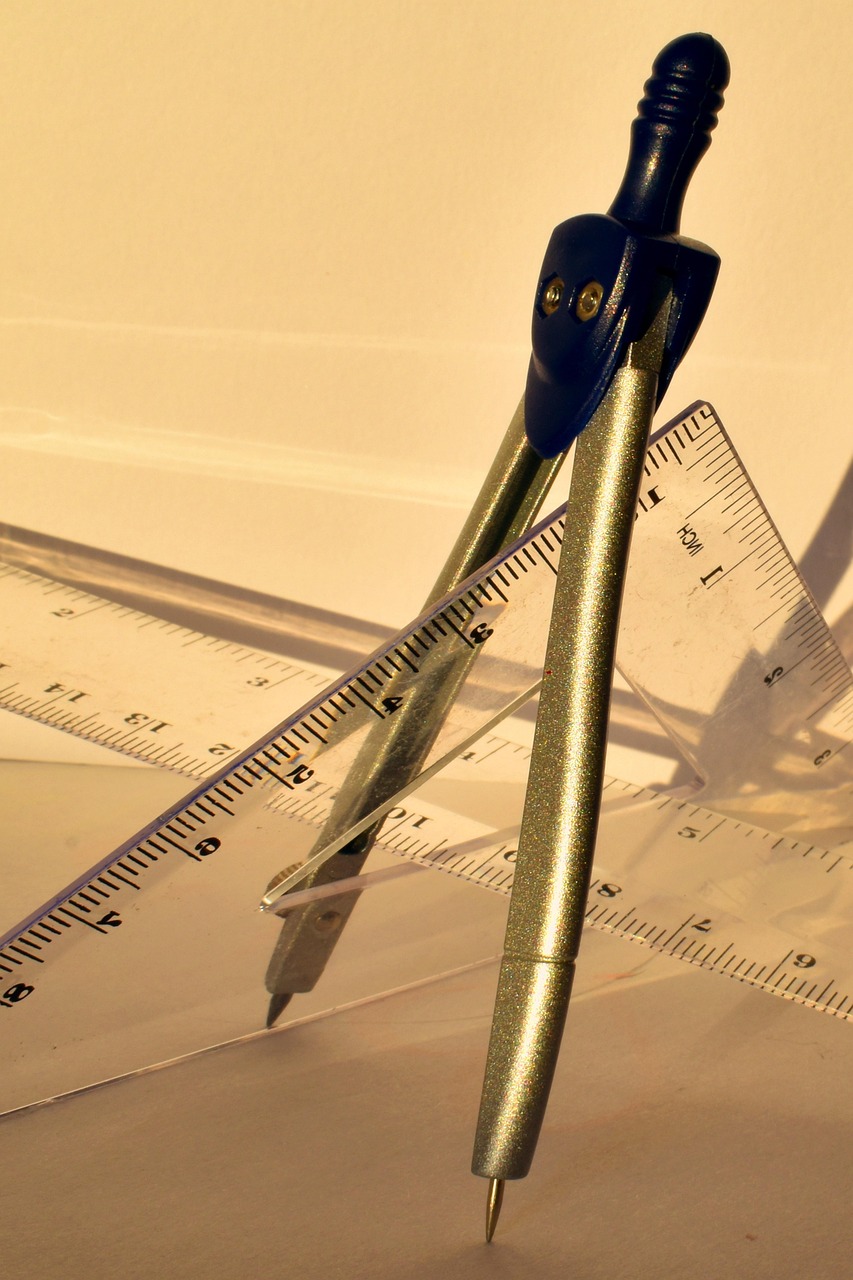



















Commentaires récents